Say it again, Sam…
C'est bizarre : de Samuel Beckett, nous conservons l'image d'un personnage de Samuel Beckett. Tout nous suggère que son regard d'aigle, son visage douloureux perché sur sa silhouette osseuse, musculeuse et noueuse se sont échappés d'une représentation d'En attendant Godot dans laquelle il aurait joué le rôle de l'arbre au bord du chemin. Comme si sa physionomie annonçait nécessairement son âme, ainsi que l'écrit Voltaire dès la première page de son Candide, notre mémoire associe Beckett à l'austérité, la sécheresse, la raideur. Il y avait de cela, certainement, car les légendes ne naissent pas de rien. Et avec cela taciturne, pas commode, sauvage, fermé. Un maître de l'incommunication. N'empêche qu'en 2010, ses lecteurs français risquent d'avoir un choc en découvrant le livre qui vient de paraître en anglais : le premier tome de The letters of Samuel Beckett 1929-1940 (Cambridge University Press), déjà encensé par la critique anglaise et américaine. Toute une vie revisitée à travers une correspondance échangée avec des amis, des peintres, des musiciens, des écrivains, des étudiants, des traducteurs, des éditeurs, le tout parfaitement « autorisé » et édité par les soins de deux spécialistes agréés du beckettland. 828 pages pleines de révélations importantes ou microscopiques distillées à travers 2500 lettres sur les 15000 qui seront publiées au final. A commencer par celle-ci qui les supplante toutes : Samuel ne ressemblait absolument pas à Beckett. Non qu'il fut double ou quelque chose du genre. Ou qu'il ait cherché à tromper son monde. Mais il était si peu expansif sur sa sphère privée qu'une fois mise à jour, elle brise l'icône confinée en son hiératisme par les médias même, ce qui n'est pas plus mal. Lui qui avait fait de l'aspiration au silence la respiration de son œuvre, on l'y découvre drôle, piquant, débridé, bavard, autocritique, éloquent, plein d'allant, scatologique, Même la manifestation de ses
épisodes dépressifs y est d'une ironie mordante. Il crée des néologismes déjà bien dans sa manière ; dans un même paragraphe, des phrases en anglais, en français ou en italien côtoient d'autres en latin ou allemand. On y trouve des échos de la guerre civile espagnole et des choses vues dans l'Allemagne de la montée du nazisme, aussi bien que des comptes-rendus de ses lectures, plus conventionnelles qu'on ne l'imagine, ou une évocation essentielle de sa cure psychanalytique et de sa solitude. N'allez pas croire que c'est là un mauvais coup posthume de ses admirateurs. Le prix Nobel 1969 avait lui-même réglé la chose, au risque que sa statue fut ébréchée. A deux conditions toutefois : « Que cela concerne mon travail » et « Pas de commentaire, s'il vous plaît ». Avis aux universitaires qui ne peuvent s'empêcher de mettre (1) leur grain de sel* au
moindre mot (a) du grand homme (2) dont ils ont la charge –mais ils ont pu obtenir de donner le contexte, ce qui est parfois plus long que la lettre elle-même, il avait bien raison de se méfier. A supposer qu'ils la publient dans le quatrième et dernier volume de cette fascinante Correspondance, sauront-ils jamais le contexte de cette carte anodine de 1986 dans laquelle Beckett écrivait à un journaliste « … avec plaisir mais, malheureusement, ma vue ne me le permet plus » ? Pour écrire son portrait à l'occasion de ses 80 ans, je lui avais demandé, non pas une interview qu'il aurait refusée, mais une partie d'échecs, qu'il aurait acceptée, disait-il, si le flou, le vague et la nuit ne l'envahissaient. Il est mort trois ans après. Fin de partie.
("Samuel Beckett photogtraphié à Portobello Road par Camilla Hill"; "Beckett dans l'uniforme de la Croix-rouge irlandaise pendant la guerre" photo D.R.; "Beckett à une répétition d'En attendant Godot (1961)" photo Roger Pic)
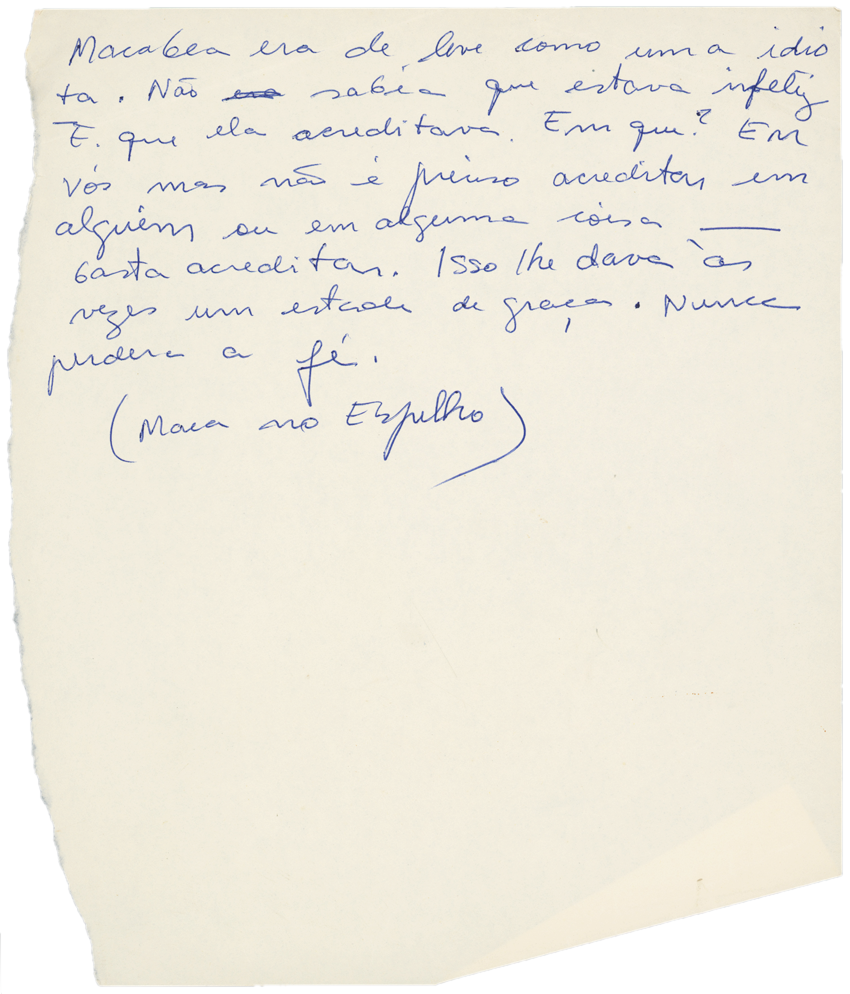
Nenhum comentário:
Postar um comentário